On voulait raconter la grande aventure.
Entre souvenirs de voyage, fiction pulp et dessins au bic. Mehdi Boucher parle d'aventure : fièvre, ennui et dépaysement radical. Le spectacle est pour celui qui la vit, pas pour celui qui la lit.
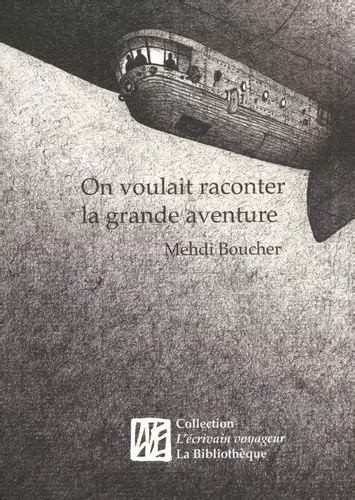
Mehdi Boucher
La Bibliothèque, 2025
J’ai pris ce livre le nez au vent, sur un de ces vagues coups de tête qui vous le font prendre en main, feuilleter, reposer, reprendre ; faire semblant d’hésiter alors qu’on sait comment ça va se terminer à l’instant où on a posé les yeux sur la couverture.
On voulait raconter la grande aventure est un livre composite. Quand on a dit ça d’un bouquin, on n’a rien dit. Mais voyez !
Il mêle les souvenirs de voyages de l’auteur, autobiographie désabusée et acerbe, avec des réflexions sur l’Histoire, la guerre, l’ennui et la création artistique. Il saupoudre par-dessus des dessins en noir et blanc qui résonnent impeccablement avec ce qu’il raconte. Et comme c’était un peu léger, il ajoute un récit de voyage pulp qui fait de gigantesques clins d’œil à Lovecraft. Excusez du peu, « composite » a encore des airs d’euphémisme pour un opuscule qui condense tout ça en 150 pages.
Ça se lit comme un souvenir — le squelette plein de petits os tarabiscotés d’un oiseau disparu, dont on ne peut qu’imaginer le chant et les plumes.
Enfant, j’ai lu des récits d’aventures dans des magazines de mon père. Ça ne ressemblait pas du tout à Indiana Jones. On s’y ennuyait en attendant un train de brousse qui n’arriverait jamais, abruti par le soleil, les fièvres et la gnôle locale. Ça m’a hanté le reste de ma vie. Hugo Pratt, quelques années plus tard, n’a pas arrangé les choses.
J’ai cessé de définir l’aventure comme un récit ordonné, ou pire, réseausociable . L’aventure commence quelque part avant le départ et, pour peu qu’elle vaille le détour, ne se termine jamais vraiment. Ce sont des voyages étranges, hors du temps, où on est parti s’ennuyer loin de chez soi, se perdre pour ne rien retrouver ; pas de révélation, juste la conscience vaguement déplaisante que qui revint n’est pas qui partit. Quasiment un récit fantastique. On boucle la boucle avec Lovecraft.
Mehdi Boucher a réussi à communiquer exactement ces impressions. Que l’aventure est une expérience racontable mais, dans son essence, indicible. Il a une plume désabusée, peut-être à cause de ça, peut-être pour d’autres raisons ; ça ne me regarde pas. Mais j’aime bien.
Dans ses meilleures pages, on pourrait jurer qu’à l’arrière-plan, Corto Maltese rajuste sa cravate en se demandant ce qu’il fout là.
« Ceux qui viennent à Yuni pour rigoler seront assez déçus : des rues qui ne vont nulle part, poussiéreuses et défoncées par la pluie, de petites maisons comme poussées du sol, en terre et en tôle, effritées par le vent et le froid, et au dessus, le ciel immense et encrassé de nuages noirs. Tout autour, à perte de vue, le grand vide de l'Altiplano bolivien.
Deux couleurs donc, et seulement deux se partagent l'horizon : ocre et anthracite, presque un tableau abstrait, désespérant et grandiose. »




